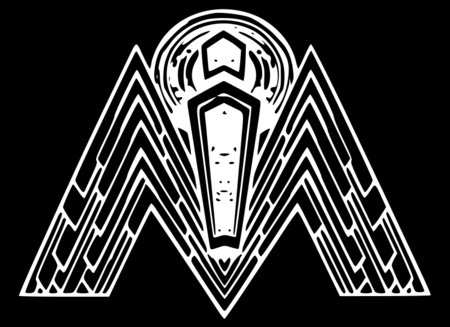La voie d'insertion
Avant qu'il ne soit récupéré par Christian Clavier en 2004, Petillon avait fait de Jack Palmer l’antihéros de sa bande-dessinée phare des années 70-80 : un détective privé complètement à la ramasse, éternellement bardé d'un sac plastique griffé Tati et, gag récurrent, qui ne parvenait jamais à décrocher son permis de conduire (une vingtaine de tentatives) mais estropiait allègrement ses moniteurs d'auto-école. Sans aller jusqu'à atteindre ce stade, force m'est d'admettre que la Blietzkrieg annoncée s'est engluée en Bérézina piteuse. D'un code de la route victorieux validé rapidement (deux mois), j'errais dans les affres des priorités à droite, des piétons inconscients, des migrations pendulaires avec, fréquemment, l'envie hargneuse de balancer mon copilote au bord de la voie et d’éperonner les agités du volant.
Si Cosa Nostra, 'Ndrangheta et Camorra pratiquent, entre autres joyeusetés, le pizzo ; le monde de l'auto-école repose aussi sur une économie du racket. Avec une leçon d'une heure facturée 45 euros, limitée à 40 minutes de conduite effective, on peut considérer l'activité de l'apprentissage de la conduite comme rentable (tout dépend de quel côté du levier de vitesse l'on se trouve). Car, quel que fût le moniteur (fumeur, buveur de café ou adepte en commérage), la pause oscillait entre la dizaine de minutes et le quart d'heure. Réglant les rétroviseurs, les euros tintaient dans ma boîte crânienne. Pink Floyd - Money.
Brochette diversifiée de moniteurs dans l'école : du timoré, du beauf sympa, du beauf con, du détendu et, plus généralement, un condensé de tout cela à la fois. Faut dire que je les avais usés jusqu'à la corde. Certains avaient quitté le navire avant le précieux sésame obtenu. J'ose espérer ne rien avoir à faire dans l'intrigue. Faites excuse. Assez rapidement il est vrai, l'aspect mécanique des choses couplé à une pédagogie fluctuante m'engonçait dans un autisme bon teint. Chaque élément du parcours révélait un ennemi imparable. Mon premier enseignant, adoptant une attitude de bellâtre renfrogné, ne faisait que peu pour me sortir de l'ornière.
Comme tout corps de métier, l'auto-école possède son vocable, comique au départ, progressivement lassant : rangement en bataille, mains à 10 heures 10 sur le volant, projection du regard, anticipation, angle mort, conduite dynamique... Les kilomètres s'étirent, les zones commerciales défilent, les véhicules s'insèrent. La case permis allait durant ces deux longues années accompagner une honnête spirale mentale de l'échec ; l'exercice devenant à mesure des faux pas plus qu'une impasse : un poids mort. Je me projetais dans des situations, rêvais de choses idiotes. Dans un songe, le moniteur me faisait suivre un poids lourd, à quelques mètres de la remorque et sur la voie rapide, pour tester mon sens du réflexe...
Première tentative en juin 2012 en milieu d'après-midi. La 207 noire, familière, m'attendait au détour d'une place d'un quartier pavillonnaire. L'inspectrice, la trentaine au chignon serré, n'annonçait rien de bon. 35 minutes et deux fautes éliminatoires plus loin (la queue de poisson n'est pas homologuée), je quittais Aplemont sûr de mon échec. Janvier 2013. Désintoxiqué du premier janvier et de ses excès, je regagne veaux, vaches, voitures. Plus concentré mais toujours aussi stressé, j'ai la veine de tomber sur un inspecteur relâché. Pas salaud, le type me met à l'aise. Pas suffisamment pour que je parvienne à m'insérer sur une voie d'accélération courbe.
15 mars 2013. La neige a précédemment recouvert une partie de l'ouest hexagonal. A l'affût d'une exclusivité molle, les médias s'engouffrent dans la brèche. Du jamais vu depuis les seventies. Les naufragés de la route émergent du petit écran, coincés dans leurs habitacles, cerné par un paysage sibérien. Le micro trottoir fonctionne à plein. La France tourne au ralenti. Deux jours après, c'est à mon tour de monter dans l'auto et de régler la profondeur du volant. Le vent est glacial. Je relâche le frein à main. Crainte : heure de pointe. Hantise : voie d'insertion.
Nouveau visage, l'inspectrice est de bonne humeur et entame une discussion suivie avec l'embarqué patron de l'auto-école. Les rues, quasi-désertes, restent meublées de blocs de glaces. Le déroulé de l'examen est connu : gros rond point, voie rapide, friches commerciales. Manœuvres aisées sur parking désert. Le papier rose se rapproche. Jusqu'à ce que, ignorante vicieuse, l'inspectrice m'ordonne de virer à droite vers la voie d'insertion. La fameuse. Je sers les fesses. Situation identique : aucun automobiliste ne daigne se déporter sur la gauche. La route arrive à son terme, comme autrefois. Jusqu'à ce qu'une âme charitable (bénie soit son nom) daigne lever le pied pour me faciliter la chose. Je soupire d'aise.
Le plus dur est fait, reste à ne pas se louper sur la fin comme ce traître camion poubelle et ses employés piégeux. Un final tendu mais je sais que c'est réussi. In da pocket ! Fendu d'un large sourire, je ris en rentrant chez moi, débarrassé de mon moderne fardeau. 2011 et 2012 s'évaporent. 2013 resplendit. Je peux détourner ma barque vers autre chose. Appelez-moi Plastic, parce que là ça commence à planer pour moi.